Le passage à vide de Bennabi conséquent à la perte de sa mère, à la précarité de sa condition matérielle et aux déceptions politiques se prolonge. Il vit à la campagne dans le calme champêtre qui lui fait tant de bien. Il ne va plus à l’Ecole, préférant travailler chez lui. Le week-end, il se rend à Paris.
Massignon doit donner un jour une conférence au siège de l’UCJG. Bennabi décide d’y assister avec les frères Ben Saï et son cousin Ali Ben Ahmed. A la fin de la conférence, ce dernier demande la parole et traite Massignon de « menteur ». C’est le scandale dans la salle.
Bennabi intervient pour calmer les esprits et, ce faisant, en profite pour commenter en des termes courtois certains jugements de Massignon sur le wahhabisme : « Mr le professeur, je crois qu’il faut considérer le wahhabisme dans l’islam comme le protestantisme dans le christianisme : c’est une Réforme. » Il conclut son intervention en proclamant qu’il est lui-même wahhabite. La salle l’applaudit mais le conférencier devient livide. Il a reçu les arguments de Bennabi avec plus de froideur qu’il n’avait reçu les outrances de Ben Ahmed (1).
L’année universitaire s’achève. Bennabi n’envisage pas de rentrer à Tébessa et passe ses vacances en Normandie comme surveillant dans une colonie de vacances. C’est dans ce petit village du Luat-Clairet (2) où il vit avec sa femme dans une seule pièce mais au milieu de la généreuse nature de Normandie qu’il prend la décision de tout laisser tomber pour partir en Orient. Il sollicite des visas à l’ambassade d’Egypte.
Tout est prêt : les passeports, les bagages, l’argent des billets de bateau, les projets, les rêves, mais on lui refuse les visas. Il a été jugé « indésirable en Egypte pour les intérêts français ». Complètement désenchanté il sort de la chancellerie, interprétant ce refus qui chamboule ses plans comme une trahison arabe à l’instigation de l’administration coloniale. Il se résigne à rester en France et, comme pour relever le défi, reprend fermement ses études. Il retourne à Paris et loue une chambre à cinq minutes de l’Ecole. Le propriétaire lui fait payer deux années de loyer d’avance.
Au Quartier latin il retrouve Hamouda qui travaille comme manœuvre à l’usine « hispano-suiza » de Bois-Colombes (3). En Allemagne, Hitler dénonce le Traité de Versailles. Les noms de Bendjelloul en Algérie et de Messali Hadj dans les milieux algériens en France sont au firmament… de la « boulitique ». Bennabi pense en lui-même qu’« il est infiniment plus difficile de former un seul homme que d’ébahir des milliers d’auditeurs avec des discours patriotiques ». Salah Ben Saï termine brillamment ses études en agronomie, un organisme le recrute et l’envoie en Guyane.
La situation de l’Algérie désespère Bennabi : d’un côté une administration déterminée à maintenir le pays dans l’ignorance et la misère, de l’autre le verbiage et le revendiquisme stérile des partis. Le problème de l’analphabétisme le hante en particulier, car il est à ses yeux la clé du problème de la renaissance.
Il rédige un article dans lequel il expose une possibilité de le résoudre par les propres moyens de la société algérienne : répartir le nombre d’analphabètes sur le nombre de lettrés. Il le propose à « La Défense » de Lamoudi et à l’ « Entente franco-algérienne » de Bendjelloul qui ne le publient pas car jugé « subversif ». Un peu plus tard, il rédige un autre article qu’il signe « Les compagnons de l’islam » et le fait parvenir au journal « L’Entente » qui ne le publie pas non plus.
En Algérie, une nouvelle affaire retient l’attention des médias. La population a décidé de boycotter une marque de cigarettes (JOB) réputée pour son engagement en faveur du sionisme. Elle prend la dimension d’une affaire d’Etat car chaque fois qu’une action collective est entreprise, l’administration coloniale s’en alarme et devient capable de toutes les extrémités. Bennabi le sait autant que le colonialisme. Il n’y a que le mouvement national qui l’ignore, ou fait semblant de l’ignorer.
En été, il rentre à Tébessa. Sa famille lui propose de se remarier avec une Algérienne qui lui donnerait des enfants. Larbi Tébessi, revenu de Sig, dirige l’ « Islah » local. Le disque égyptien a évincé des cafés populaires Aïssa Djermouni (1886-1946). Son père s’est détaché du monde et ne s’intéresse plus à rien.
On lui présente un jour au café le « Hoggar » un couple de Français convertis à l’islam, M. Anacléto Cyril et sa femme qui, emportés par leur nouvelle foi, se croient obligés d’adopter jusqu’aux aspects les plus superficiels de la vie des musulmans, liquidant leur ameublement moderne pour le remplacer par des tapis et des divans, et troquant leur habillement occidental contre « chéchia » et « séroual » pour l’homme, et foulard nord-africain pour la femme.
Bennabi ne comprend pas cet excès de zèle mais devient ami avec Anacléto dont il dit dans ses Mémoires inédits : « Je lui dois beaucoup. Non seulement de m’avoir mis sur la voie de certains problèmes ; il a souvent aussi contribué à leur solution dans mon esprit tant par sa propre érudition qui n’était pas négligeable, que par sa bibliothèque islamique qui était importante. »
C’est à la même époque qu’il rend visite à Eugène Jung dont il dira : « Le vieil homme, le vaillant lutteur qui initia ma génération, usé et désabusé, s’éteignait doucement comme la chandelle qui éclairait ses derniers instants dans cette mansarde qui n’était pas même éclairée à l’électricité » (« MTS » II).
Un jour qu’il est attablé à une terrasse de café parisien vers la fin du mois de février 1936, lisant le journal « L’Entente », il tombe sur un article de Ferhat Abbas au titre inattendu : « La France c’est moi ! ». Il le parcourt et manque d’étouffer. Les jours suivants il apprend que l’article, une réponse à un écrit publié par un journal parisien, « Le Temps », a commotionné le pays.
Dans ce brûlot devenu historique, Ferhat Abbas écrit :
« Avec cette légèreté du geste et de la pensée des gens mal informés, le journal « Le Temps », inspiré sans doute par la haute finance coloniale ou la démence de quelques hommes politiques, reprend les hostilités contre l’Algérie musulmane en lui jetant à la face toutes les vieilleries que l’arsenal colonial utilise périodiquement depuis une cinquantaine d’années : nationalisme, fanatisme religieux, wahhabisme…
La question qui m’intéresse est celle de l’enseignement de l’arabe posée par « Le Temps ». Cette langue est pour la religion musulmane ce que l’Eglise est pour la religion catholique. Elle ne saurait vivre sans elle… Wahhabisme et panarabisme sont des paravents fragiles derrière lesquels s’abritent les véritables desseins de nos gros éducateurs coloniaux. La masse à laquelle ils ont refusé l’école française doit être privée de l’enseignement arabe. Ni culture française, ni culture arabe… Si les oulémas étaient des « racistes », des « panislamistes », nous, amis politiques du Dr. Benjelloul, nous serions des nationalistes. L’accusation n’est pas nouvelle…
Mon opinion est connue. Le nationalisme est ce sentiment qui pousse un peuple à vivre à l’intérieur de frontières territoriales, sentiment qui a créé ce réseau de nations. Si j’avais découvert la « nation algérienne », je serais nationaliste et je n’en rougirais pas comme d’un crime. Les hommes morts pour l’idéal national sont journellement honorés et respectés. Ma vie ne vaut pas plus que la leur. Et cependant, je ne ferai pas ce sacrifice.
L’Algérie en tant que patrie est un mythe. Je ne l’ai pas découverte. J’ai interrogé l’histoire ; j’ai interrogé les morts et les vivants… j’ai visité les cimetières : personne ne m’en a parlé. Sans doute ai-je trouvé « l’Empire arabe », « l’Empire musulman », qui honorent l’islam et notre race, mais ces empires se sont éteints. Ils correspondaient à l’Empire latin et au Saint-Empire romain germanique de l’époque médiévale. Ils sont nés pour une époque et une humanité qui ne sont plus les nôtres… Ce que l’on veut combattre derrière ce mot, c’est notre émancipation économique et politique. Et cette double émancipation, nous la voulons avec toute la force de notre volonté et de notre idéal social.
Six millions de musulmans vivent sur cette terre devenue depuis cent ans française, logés dans des taudis, pieds nus, sans vêtements et sans pain. De cette multitude d’affamés, nous voulons faire une société moderne par l’école, la défense du paysannat, l’assistance sociale… Sans l’émancipation des indigènes, il n’y a pas d’Algérie française durable. La France, c’est moi parce que moi je suis le nombre, je suis le soldat, je suis l’ouvrier, je suis l’artisan, je suis le consommateur. Ecarter ma collaboration, mon bien-être et mon tribut à l’œuvre commune est une hérésie grossière. Les intérêts de la France sont nos intérêts dès l’instant où nos intérêts deviennent ceux de la France… (4) ».
Bennabi en délibère avec ses amis et décide de riposter à cette négation de la nation algérienne. Rentré chez lui, il se met au travail. Le titre qu’il choisit à son article, « Intellectuels ou intellectomanes», introduit le premier néologisme de la terminologie bennabienne. Le lendemain, il le montre à ses amis. Hamouda Ben Saï le recopie pour le lire partout, tandis que l’original est envoyé à Lamine Lamoudi en vue d’être publié dans « La Défense ». Celui-ci refuse sa publication (5).
La lecture de cet article nous révèle un Bennabi plus sensible aux questions idéologiques qu’aux questions politiques puisque c’est à la première partie de l’éditorial de Ferhat Abbas qu’il semble répondre, montrant combien il a été heurté dans ses convictions « salafistes ».
Par la même, il rapporte dans ses Mémoires inédits les sensations qu’éprouve l’écrivain en herbe devant son premier essai : « Pour la première fois de ma vie, je faisais un effort d’accouchement intellectuel. Chaque problème pratique ou théorique en exige un. Mais pondre un article, c’était nouveau pour moi. Je lui avais donné pour titre « intellectuels ou intellectomanes ? » Le néologisme (6) avait jailli dans mon esprit comme un dard que je plantais fougueusement dans l’orgueil des nouveaux « zaïms »… Quand je l’eus lu le lendemain au repas de midi à ma femme, elle me dit : « Ça, ce n’est pas de toi, c’est de l’inspiration. » C’était en effet de la prose de haute volée. »
Voici dans son intégralité l’écrit en question :
« Est-ce un enterrement que l’Algérie doit célébrer ? Après le faux miracle maraboutique, le mirage intellectuel doit-il se dissiper à son tour ? Notre « élite » se meurt ! … Notre « élite »… a vendu son âme. C’eut été un sujet pour Goethe. Malheureusement, ce n’est qu’une farce triviale. Jusqu’ici, nous avions cru que nos « intellectomanes » se contenteraient de monnayer leurs talents de bouffons dans la foire politique. Mais la parodie ne suffit plus.. Car voici que la farce se hausse au mélodrame et que les polichinelles se prennent soudain au sérieux.
C’est Abbas Ferhat qui se découvre une vocation d’archéologue et va fouiner dans « les cimetières ». Je le connaissais déjà comme farceur depuis « Le jeune Algérien ». Ne nous a –t-il pas indiqué dans son livre un régime de larmes comme remède à nos maux ? « Pleurer comme la fille d’Hamilcar », c’est bien de lui.
Parmi tant de déchéances, l’Algérie connaît un mal nouveau : l’ « intellectomanie ». La zaouia et l’imprimerie ont fait les mêmes ravages. L’ignorance du peuple et « l’instruction » des « intellectomanes », voilà nos deux fléaux. Hier, l’amulette et aujourd’hui le bouquin. Quel est le pire, Abbas, où est la différence ?
Hier les pachas de Constantine, vos aïeux, obligeaient les Juifs de se déchausser pour passer devant eux. C’était odieux. Aujourd’hui, pour répondre au « Temps », la feuille juive devenue la mieux camouflée et la plus vénale, tu déchausses pour ainsi dire ton âme et tu bafoues ton passé. C’est ignoble.On nous accuse de « panislamisme » ? Et pourquoi pas d’islam tout court ?
La presse stipendiée du veau d’or sait créer astucieusement les mythes qui font peur. C’est à dessein que notre islam est affublé de ce « pan » qui sème la panique dans les rangs de nos valeureux « intellectomanes » ! Mais toi Abbas ? Tu te trompes ou tu nous trompes. Hier n’est pas notre passé ! Notre passé est avant le narguilé et le harem, avant les courtisans et les favoris, les marabouts et les « intellectomes ». Notre passé, c’est notre âme trempée dans le sang versé à Siffin. C’est aussi notre avenir » (7).
La riposte de Ben Badis à l’article de Ferhat Abbas paraît, elle, en avril dans le journal de l’ Association des Oulamas, « ach-Chihab », où on peut lire :
« Vous ne nous représentez point. Vous ne parlez pas en notre nom, et vous ne traduisez ni notre sentiment, ni notre pensée. Nous, nous avons scruté les pages de l’histoire et la situation présente. Et nous avons trouvé la nation algérienne et musulmane, formée et existante, comme se sont formées et ont existé toutes les nations du monde. Cette communauté a son histoire, pleine de hauts faits. Elle a son unité religieuse et linguistique. Elle a sa culture propre, ses habitudes et ses mœurs, bonnes ou mauvaises, comme chaque nation ici-bas.
De plus, cette nation algérienne et musulmane n’est pas la France. Elle ne saurait être la France. Elle ne veut pas devenir la France. Elle ne pourrait pas le devenir, même si elle le voulait. C’est une nation que la langue, les mœurs, la race et la religion distinguent de la France. Elle ne veut pas s’y intégrer. Elle a une patrie définie et limitée : c’est l’Algérie dans ses frontières actuellement reconnues et dont l’administration est confiée à M. le Gouverneur général désigné par l’Etat français. De plus, cette patrie algérienne musulmane est pour la France une fidèle amie. Sa fidélité est celle du cœur et non point une fidélité apparente. Elle lui offre la sincérité de l’ami pour son ami et non point celle du domestique pour son maître.
Dans la paix et la sécurité, elle demande à la France de respecter sa langue et sa religion, de lui aplanir la voie du progrès dans le cadre de sa religion, de sa langue et de sa morale propres. Elle lui demande de la gratifier de la liberté, de la justice et de l’égalité, afin de devenir un modèle de progrès, d’égalité et de bien-être et pour l’administration française et pour la coopération franco-indigène…
Dans une situation de crise mondiale, au moment où les choses s’aggravent, où la poudre a la parole et où l’épée de Damoclès menace, le musulman algérien s’éveille, tel le lion dans sa tanière pour protéger le sol français, tout comme il défendrait sa terre algérienne, sa femme et ses enfants.
Aussi, nous, Algériens musulmans qui vivons dans notre patrie algérienne à l’ombre du drapeau tricolore français et unis solidement avec les Français, dans une union que n’affectent ni les petits évènements ni les crises superficielles, nous vivons avec les Français en amis fidèles. Nous respectons leur gouvernement et leurs lois, nous obtempérons à leurs impératifs et à leurs interdits. Et nous voulons qu’ils respectent notre religion et notre langue, qu’ils protègent notre dignité et qu’ils nous guident dans la voie de la renaissance politique, sociale et économique. Ainsi, nous vivrons ensemble comme de fidèles amis, et, si l’heure de mourir au service de la défense de la patrie française ou algérienne venait jamais, elle nous trouverait au premier rang, prêts à mourir côte à côte, en amis fidèles. » (8).
Au printemps 1936, Léon Blum forme le gouvernement du Front Populaire. A Alger, un grand événement se prépare qui comble Bennabi de joie : les Oulamas, les Elus et les Communistes décident de se regrouper au sein du « Congrès Musulman Algérien ». Pour lui, c’est un signe de maturité et l’augure d’une action politique décisive pour l’avenir du pays. Seule fausse note, l’Etoile Nord-Africaine de Messali refuse de se joindre à la réunion qui se tient le 07 juin 1936 dans une grande salle de cinéma à Bab El-Oued. Quatre mille personnes y participent.
Le Congrès débouche sur une « Charte revendicatrice du peuple algérien musulman » qui demande la fin du Code de l’indigénat, le rattachement de l’Algérie à la France, l’indépendance du culte et l’officialisation de la langue arabe.
A deux ou trois jours de l’examen final devant lui permettre d’obtenir son diplôme, Bennabi apprend la venue à Paris d’une délégation du Congrès présidée par le Dr. Bendjelloul. Elle est reçue le 23 juillet par le chef du gouvernement Léon Blum et par le sénateur Maurice Viollette.
Bennabi et ses amis sont étonnés de cette démarche. Ils décident d’aller voir la délégation descendue dans un grand hôtel de Paris où la « abaya » (tunique) blanche des « chouyoukh » (pluriel de « cheikh ») leur semble tout à fait déplacée en ces lieux où se bousculent les vedettes et les soubrettes de Paris. Ils trouvent là Ben Badis, Bachir al-Ibrahimi, Tayeb al-Okbi, Ferhat Abbas, Lamine Lamoudi et Bendjelloul.
Bennabi aborde les Oulamas et leur exprime la déception de son groupe qui ne comprend pas que ce rassemblement de partis qui a soulevé une immense espérance politique dans le pays retombe dans les revendications et les suppliques. « Que venez-vous faire ici ? la solution est en Algérie ! elle est entre vos mains et non entre celles du gouvernement français. » Puis il prend en aparté Lamoudi et lui demande pourquoi il n’a pas publié sa réponse à Ferhat Abbas. Celui-ci lui dit : « Nous avons trop peu d’hommes politiques pour les détruire ».
C’est en de pareils moments que Bennabi perd complètement foi en l’ « Islah », et ces moments seront nombreux ; c’est en ces occasions qu’il a pour les Oulamas les jugements les moins amènes. Il confie à son journal : « Dès cette année 1936, j’avais fait pratiquement mon deuil des oulamas qui me paraissaient aussi bien incapables de comprendre une idée ou de la créer, que de l’appliquer. »
Ils s’en vont, ses deux compagnons et lui, la mort dans l’âme, se consolant mutuellement avec le rappel d’un hadith : « L’islam est né dans l’exil et il reviendra à l’exil. Oh ! que la paix de Dieu soit alors sur les exilés » (9).
A suivre…
NOTES :
1 Celui-ci mourra dans des circonstances non élucidées en 1942. Bennabi dit à son propos dans ses Mémoires inédits : « Ali Ben Ahmed doit rester dans l’histoire algérienne comme l’initiateur de l’expression révolutionnaire dans son journal « La voix du peuple ». C’est le premier qui appela le voleur, un voleur, même quand il s’agissait du tout puissant Mirante ou de Massignon lui-même » Pour lui, c’est le « psychological service » qui aurait organisé son meurtre par empoisonnement. (M. Mirante était directeur des affaires indigènes au Gouvernement général).
2 Village près de Dreux, dans le département d’Eure-et-Loir qui porte actuellement le nom de Luray.
3 Se rappelant ses souffrances de l’époque, HBS écrit dans « Au service de ma foi » : « Ayant appris cela, Cheikh Ben Badis avait eu des larmes aux yeux. Au camarade étudiant qui lui avait parlé de moi, il avait dit : « Pourquoi ne nous a-t-il pas écrit ? Nous avons une caisse pour aider les étudiants pauvres. »
4 « On peut pendre n’importe qui avec des extraits » dit-on. Et de fait, Ferhat Abbas le sera haut et court pour cet article et surtout les extraits qui en seront faits, tant par les Algériens, sa vie durant et au-delà, que par les Français, à partir de 1943, quand il se mettra à revendiquer une nation algérienne et un Etat souverain. Un militant pur et dur du PPA aux antipodes des idées de Ferhat Abbas, Ahmad Mahsas, écrit dans son livre : « Sur le plan individuel, certains de ces élus comme F. Abbas, en dépit de ses déclarations, avaient le comportement d’un nationaliste qui s’ignore. » (op.cité).
5 L’article de Ferhat Abbas a été publié dans le journal « L’Entente » de la « Fédération des élus », et le lendemain dans « La Défense », journal francophone de l’Association des Oulamas. L’article de Bennabi quant à lui ne sera publié en version arabe qu’en novembre 1991 dans une revue paraissant à Batna, « El Raouassi », qui pourrait l’avoir obtenu de HBS qui vivait à Batna.
6 Bennabi l’utilise pour la première fois dans « Le phénomène coranique » (1947).
7 Bennabi poursuivra longtemps de ce reproche Ferhat Abbas, puisqu’on le voit le fustiger encore en 1970 à propos de cette « négation qui jeta l’effroi » (cf. « A la mémoire de Ben Badis », op.cité).
8 « Ach-Chihab », avril 1936.
9 Dans son témoignage de 1984, HBS donne une version d’une tonalité différente, écrivant : « En 1936, une délégation d’Elus à laquelle participaient les Oulémas vint à Paris. Représentant le « Congrès Musulman Algérien » qui avait réalisé la quasi-unanimité de nos populations, elle présenta un cahier de revendications qui méritaient d’être prises en considération. Au « Grand hôtel », près de la place de l’Opéra, je vis le cheikh Ben Badis en compagnie de cheikh al-Okbi et du cheikh Bachir Brahimi. Je le revis encore au café « Le Hoggar » où je lui présentai des camarades égyptiens qui préparaient des thèses de doctorat en droit. Content de voir ces jeunes intellectuels arabes, il nous tint durant près d’une heure sous le charme de sa parole… ».
Puis HBS ajoute : « La délégation algérienne, n’ayant rien obtenu, rentra en Algérie. Le cheikh Ben Badis, ulcéré et comprenant que le socialisme du Front Populaire n’était qu’un mirage trompeur et que le colonialisme français, plus intraitable que jamais, demeurait sourd aux appels de l’humanisme et de la raison, écrivit un article admirable sous ce titre saisissant : « Confions notre cause à Dieu et comptons sur nous-mêmes ». Je ne devais plus le revoir vivant. »


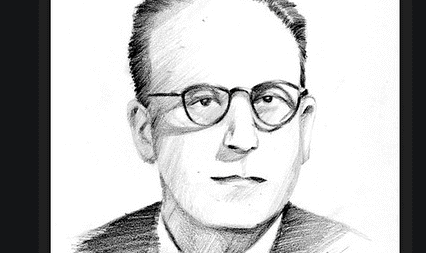


Chargement…